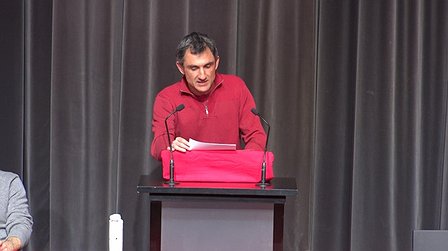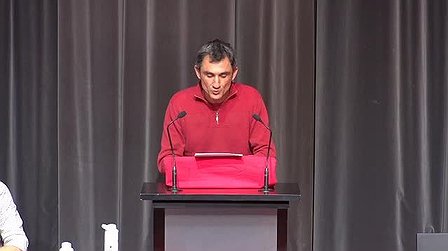De Mayotte à la Nouvelle-Calédonie, l’impérialisme français contre les peuples
Au sommaire de cet exposé
Sommaire
- La prise de possession française
- 17e-18e siècle : la bourgeoisie française se lance dans le pillage colonial
- La bourgeoisie française à la recherche de point d’appui dans le Pacifique et l’océan Indien
- La guerre contre les Kanaks
- La formation d’un prolétariat en Nouvelle-Calédonie
- La soumission des Polynésiens pour leur voler la terre
- La Réunion et le prolétariat de la canne
- Mayotte… pour conquérir Madagascar
- Le prolétariat des îles et le mouvement ouvrier
- L’impérialisme français face aux aspirations anti-coloniales des peuples
- À Madagascar, la répression sanglante de l’insurrection contre l’ordre colonial
- La Réunion : le PCF organise la collaboration de classe
- Les Comores : l’impérialisme charcute les peuples
- La vie des peuples d’Océanie chamboulée par la Deuxième Guerre mondiale
- La soumission des Polynésiens pour tester la bombe
- Le massacre des Kanaks et l’intégration de leurs chefs pour tenir dans le Pacifique
- Aujourd’hui, l’impérialisme français se comporte toujours en puissance coloniale
- Une puissance de seconde zone qui cherche à tenir son rang
- Mayotte : gouvernement français et petite bourgeoisie mahoraise organisent la guerre entre pauvres
- La Réunion : du patriotisme économique réunionnais à la xénophobie
- La Polynésie : les indépendantistes au service du patronat local
- La Nouvelle-Calédonie : le combat des Kanaks, un espoir pour tous les opprimés des îles
- Conclusion
Le 13 mai 2024 et dans les semaines qui ont suivi, des milliers de jeunes, de pauvres, de travailleurs kanaks se sont révoltés, entraînant toute une partie de la jeunesse d’origine océanienne. La cause immédiate de cette révolte était le dégel du corps électoral projeté par le gouvernement français en Nouvelle-Calédonie. Cette mesure administrative reniant les promesses des décennies précédentes, rendait les Kanaks minoritaires sur leurs propres terres en permettant à des résidents fraîchement arrivés sur l’île de participer aux référendums sur son avenir. Cette provocation fut vécue par les Kanaks comme une déclaration de guerre. Elle a agi comme un détonateur, faisant exploser la colère accumulée par des décennies d’oppression. La répression fut brutale. Onze des quatorze morts qu’il y eut dans ces événements sont des Kanaks, sept de leurs dirigeants ont été déportés dans les prisons de métropole. Mais le pouvoir a dû remballer, au moins pour un temps, son projet.
À Mayotte, à douze mille kilomètres de la Nouvelle-Calédonie, le passage de l’ouragan Chido en décembre dernier a été un révélateur du mépris colonial de l’impérialisme français. La première mesure prise par l’État français n’a pas été d’envoyer de l’eau, des soignants, des médicaments et de la nourriture mais de décréter un couvre-feu, d’y dépêcher des milliers d’hommes en armes et des engins blindés pour maintenir l’ordre et faire la chasse aux étrangers. Alors que la population manque de tout, c’est le droit du sol que l’État a décidé de durcir, rendant la vie encore plus difficile à ceux des pauvres de l’île qui n’ont pas les papiers français, créant un fossé de haine entre ceux qui en ont et ceux qui n’en n’ont pas, alors que tous sont issus du même peuple.
Depuis près de deux siècles qu’il domine ces îles, l’État français décrète qui peut ou ne peut pas y vivre, qui a le droit ou n’a pas le droit de voter. Il désigne ceux qu’il considère comme indésirables, il réprime, tue, sépare les peuples. Pour mieux régner, il dresse les opprimés les uns contre les autres.
Dans l’océan Indien, à Mayotte comme à La Réunion, dans l’océan Pacifique, en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie, la France agit toujours en puissance coloniale. C’est vrai aussi en Guadeloupe et en Martinique dont nous ne parlerons pas aujourd’hui et où nos camarades de Combat ouvrier défendent une politique communiste révolutionnaire auprès des exploités.
Ces territoires et les peuples qui les habitent sont aujourd’hui comme hier autant de pions que l’impérialisme français utilise pour atteindre ses objectifs de puissance. Alors qu’il a perdu l’essentiel de ses possessions en Asie et en Afrique lors de la vague de décolonisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, l’État français a réussi à maintenir là-bas sa domination directe, avec ses institutions, sa police et son armée, sur des centaines de milliers de pauvres et de travailleurs.
La situation à Mayotte, comme la révolte l’année dernière en Nouvelle-Calédonie, nous montrent que dans ces colonies, des explosions sociales peuvent survenir à tout moment. Dans quel sens ces explosions auront lieu ? Quelles perspectives pourraient-elles ouvrir pour les travailleurs et les opprimés non seulement de ces îles mais aussi de la métropole et de toutes les régions voisines, voilà ce que nous voulons discuter aujourd’hui, en revenant d’abord sur cette histoire coloniale.
La prise de possession française
17e-18e siècle : la bourgeoisie française se lance dans le pillage colonial
La bourgeoisie française s’est lancée dès le 17e siècle dans le pillage de territoires outre-mer et dans la soumission des peuples qui les habitaient. Sous l’impulsion de Colbert, ministre de Louis XIV, militaires et fonctionnaires accompagnés de missionnaires permirent à cette classe de marchands d’accumuler une formidable masse de capitaux qui fut à la base de son développement industriel.
La France n’était alors que peu présente dans l’océan Indien et l’océan Pacifique, qui étaient dominés par l’Angleterre, la Hollande et leurs compagnies des Indes orientales. Ces compagnies étaient de véritables multinationales commerciales dotées d’une puissante flotte, d’une force armée et disposant des prérogatives d’État sur les territoires qu’elles avaient conquis. C’est en 1664 que Colbert fonda une compagnie similaire à laquelle il donna l’année suivante en toute propriété l’île Bourbon, l’actuelle Réunion, pour la mettre en exploitation.
Cette Compagnie française des Indes orientales tenta de se faire une place entre les Anglais et les Néerlandais en installant des comptoirs commerciaux en Inde et dans les îles voisines de La Réunion, en particulier l’île de France, l’actuelle île Maurice. Cette dernière devint le centre des possessions françaises dans l’océan Indien au 18e siècle. La France y installa sa principale base militaire navale et mit en culture ses forêts pour y développer les plantations de canne à sucre. L’île Bourbon avait pour tâche de nourrir l’île de France ainsi que les escadres françaises de l’Océan Indien. Ces possessions firent le bonheur des actionnaires de la Compagnie des Indes, des commerçants qui faisaient des affaires avec les cours des sultans des Indes, ainsi que des colons exploitant les plantations des îles. Ces possédants s’enrichissaient de l’exploitation de leurs esclaves. 200 00 esclaves venant d’Afrique, de Madagascar ou des côtes indiennes furent introduits à Bourbon.
L’esclavage n’était pas le fait de trafiquants sadiques et sanguinaires, c’était un élément constitutif et officiel de la politique coloniale française. Il était organisé méthodiquement par le Code Noir qui faisait des esclaves des meubles, c’est-à-dire des biens que le maître pouvait librement vendre ou échanger comme de vulgaires objets. Le code réglementait leur vie, leur mort, leurs allées et venues, leur nourriture. Le fouet, la marque au fer rouge, les mutilations, la mort par pendaison étaient les châtiments infligés aux esclaves en cas de désobéissance ou de rébellion.
Voilà comment se sont bâties les fortunes de cette colonie, en « suant le sang et la boue par tous les pores », pour reprendre les mots de Marx.
La Révolution française ne dérangea guère le fonctionnement de la société de ces îles Bourbon et de France. Suite à la révolte des esclaves de Saint-Domingue dans les Caraïbes, l’esclavage fut aboli en 1794. Mais la bourgeoisie révolutionnaire de métropole profondément liée aux négriers des ports n’eut pas la volonté de faire appliquer l’abolition, et les planteurs purent continuer à exploiter leurs esclaves dans les mêmes conditions, jusqu’à ce que Napoléon rétablisse l’esclavage en 1802.
La bourgeoisie française à la recherche de point d’appui dans le Pacifique et l’océan Indien
La bourgeoisie française était sortie affaiblie des guerres napoléoniennes. Dans l’océan Indien, l’Angleterre l’avait dépossédée de sa principale base militaire à l’île Maurice, ne lui laissant que l’île appelée dorénavant île de La Réunion. Mais la bourgeoisie française, disposait désormais d’un État à sa main qui mit tous les moyens pour financer les infrastructures nécessaires à son développement. L’État français remit sur pied sa flotte de guerre pour se lancer à la conquête des océans Pacifique et Indien où les territoires à prendre étaient nombreux.
Vers 1840, Guizot, le ministre des affaires étrangères, déclara « Il est indispensable […] de posséder sur les points du globe qui sont destinés à devenir de grands centres de commerce et de navigation, des stations maritimes sûres et fortes qui servent de points d’appui à notre commerce et où il puisse se ravitailler et chercher refuge ».
Cette politique des « points d’appui » aboutit dans l’océan Indien à l’annexion de Mayotte en 1841, en Océanie à celle des îles Marquises et Tahiti en 1842 et enfin à la conquête de la Nouvelle-Calédonie en 1853.
La conquête de ces archipels se fit en soumettant les peuples qui y vivaient, par la force ou par la ruse. En y installant ses militaires, ses curés et son administration, comme dans toutes ces colonies, la bourgeoisie a bouleversé ces territoires. Guerres et massacres, soumission et relégation des populations ont accompagné son installation. Dans le même temps, elle y développa une économie coloniale dont surgit un prolétariat moderne aux origines diverses et variées.
La guerre contre les Kanaks
Lors de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, en 1853, l’archipel situé à 3 000 km à l’est de l’Australie, était peuplé de Mélanésiens, qu’on appelle aujourd’hui les Kanaks, et qui avaient déjà subi les ravages de la présence européenne. Baleiniers, négociants de bois de santal de tous horizons débarquaient régulièrement depuis le début du 19e siècle en Nouvelle-Calédonie. Les épidémies, l’alcool et les violences qui les accompagnaient décimèrent la population qui avait déjà chuté en quelques décennies de 300 000 personnes à environ 100 000 au moment où l’État français colonisa l’archipel.
La colonisation de la Nouvelle-Calédonie fut une des plus féroces. Dès son arrivée, considérant que les terres n’étaient habitées que par des sauvages qui devaient s’incliner devant les représentants des races supérieures, le pouvoir spolia sans ménagement les Kanaks de leurs terres. Le gouverneur se comportait en propriétaire et maître de l’île. Il décréta que les Kanaks n’auraient droit qu’à 1/10 des terres et qu’ils seraient parqués dans des réserves choisies par lui-même. Des dizaines de milliers d’hectares de terres volées furent attribués aux premiers colons de l’île. Des terres furent affectées au bagne que le gouvernement français ouvrit de 1864 à 1897 pour y enfermer plus de 30 000 prisonniers, la plupart condamnés aux travaux forcés. Ils étaient en majorité des droits communs. Mais 4 000 d’entre eux furent des révoltés de la Commune de Paris de 1871, parmi lesquels la révolutionnaire Louise Michel. Ce bagne fut aussi la destination des Kabyles insurgés contre la France en Algérie la même année.
Une fois leur peine purgée, les ex-bagnards avaient l’obligation de demeurer sur l’archipel pour y cultiver des micro-lopins de mauvaises terres impossibles à travailler. Condamnés à vivoter de petit boulot les ex-bagnards partageaient bien souvent la relégation des Kanaks. Malgré les obstacles mis par le pouvoir colonial, malgré les préjugés contre les peuples colonisés chez les bagnards, y compris parmi les communards, des contacts entre tous ces opprimés eurent lieu. Louise Michel put ainsi entretenir des liens avec les Kanaks et à travers elle, le mouvement ouvrier français commençait à s’intéresser à la question coloniale.
Elle prit fait et cause pour leurs révoltes, qui éclatèrent dès les premières années de la colonisation française, contre le vol des terres et aussi contre le travail forcé que cherchait à leur imposer le pouvoir. Pendant les vingt premières années de la colonisation, la guerre fut impitoyable. Un commandant affirmait « Il faut commencer par détruire cette population si l’on veut vivre en sécurité dans le pays ». L’armée était prête à les exterminer. Malgré les massacres, les destructions de récolte, les incendies de cases, elle ne parvenait pas à les mater. En 1878, le pouvoir dut faire face à un puissant soulèvement qui regroupa 3 000 combattants derrière le chef Ataï, attaquant des dizaines de fermes et tuant près de 200 colons. Il fallut 18 mois à l’armée, à laquelle se joignirent beaucoup de bagnards et de colons blancs, près de 1 200 morts chez les Kanaks, la destruction systématique de leurs villages pour que les colonisateurs français en viennent à bout.
Comme partout et à chaque époque, la bourgeoisie coloniale chercha à diviser le camp adverse, en trouvant des points d’appui chez les colonisés. Tel un symbole, Ataï fut finalement tué au combat par un Kanak d’un clan rallié au colonisateur. Sa tête conservée dans un bocal de formol fut montrée à Nouméa comme un trophée avant d’être expédiée en métropole où elle resta jusqu’en 2014.
La formation d’un prolétariat en Nouvelle-Calédonie
Dans le Manifeste du Parti communiste, écrit en 1848, à l’époque dont nous parlons, Karl Marx et Friedrich Engels faisaient le constat que « la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu’aux nations les plus barbares », qu’elle « force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production ».
En Nouvelle-Calédonie, la décennie 1890 fut en ce sens un tournant. Le territoire était riche du nickel. Depuis les années 1860, les sociétés minières et la principale d’entre elles, la société le Nickel, propriété de la banque Rothschild, bénéficiaient du travail gratuit des milliers de bagnards que l’administration coloniale mettait à leur disposition.
Mais les bagnards n’étaient pas assez productifs à leurs yeux, ils furent remplacés par des travailleurs que l’administration se chargea elle-même d’aller chercher. De Java, des Nouvelles-Hébrides – l’actuel Vanuatu -, d’Indochine et du Japon, des milliers de travailleurs de tous horizons débarquèrent en Nouvelle-Calédonie. C’étaient les « engagés », soumis à un statut proche de l’esclavage qui les obligeait à travailler entre deux et cinq ans dans les mines au service d’un patron qu’ils ne pouvaient quitter, qui avait toute autorité sur eux et les faisait trimer 12 heures par jour, tous les jours. Ils vivaient entassés dans des dépôts, de véritables prisons, sous contrôle de l’administration, et qu’il leur était interdit de quitter sous peine de punition.
En parallèle l’administration fit venir des travailleurs de France. L’espoir d’une vie nouvelle et de l’acquisition d’une propriété convainquit quelques milliers de membres de classes populaires de métropole de venir tenter leur chance. Certains s’enfoncèrent dans la pauvreté sur des terres incultivables pendant que d’autres, bénéficiant de la proximité des mines, arrivèrent à faire prospérer leur exploitation ou leur commerce et à placer leurs enfants dans les postes à responsabilité de l’industrie minière. Ils commencèrent à constituer cette population blanche qu’on appela plus tard les Caldoches, farouchement attachée à sa petite ou grande propriété et, dans son ensemble, profondément hostile aux Kanaks. Avec eux, l’État français s’était donné une base sur laquelle il allait s’appuyer pour maintenir sa domination.
Le pouvoir colonial accentua la relégation et l’oppression des Kanaks. Sommés de quitter les terres les plus fertiles, leurs clans furent cantonnés dans ce que l’administration appela des tribus. Ils y étaient soumis à l’autorité d’une hiérarchie de chefs désignés parmi ceux des leurs que le pouvoir colonial avait choisis pour les surveiller. Le gouvernement les soumit aux rigueurs du code de l’indigénat, un régime disciplinaire qui laissait les mains libres au pouvoir pour les enfermer, les séquestrer ou leur confisquer leurs biens sous n’importe quel prétexte. Au début du 20e siècle, les Kanaks n’occupaient plus que 8 % de la superficie de la Grande Terre. Ils faillirent même disparaître, ils n’étaient plus que 27 000 en 1921. Pourtant ils continuèrent à se battre. Lorsque l’État les contraignit à s’engager pour aller mourir à la guerre en Europe, en 1917, une partie des clans se souleva autour du chef de Tiamou, Noël, fils d’un insurgé de 1878. Durant près d’un an, environ 300 guerriers kanaks menèrent une guérilla contre des postes militaires et des stations d’élevages des colons. La répression par l’armée fit près de 200 morts et Noël fut assassiné par un colon.
Le colonisateur mit tout en œuvre pour séparer les Kanaks du reste de la population pauvre de l’île qui aurait pu se lier à leurs combats. En plus des humiliations quotidiennes dans l’île, il leur infligea celle d’être exhibés comme des bêtes dans un zoo lors de l’exposition coloniale de 1931 en métropole. Cela lui permettait d’enraciner un profond racisme chez toute une partie des Caldoches sur lesquels l’impérialisme cherchait à s’appuyer. Malgré tout, les Kanaks, dominés, expropriés, ravalés par l’impérialisme au rang de sous-hommes, n’ont jamais cessé de se battre.
La soumission des Polynésiens pour leur voler la terre
À 4 500 km à l’est de la Nouvelle-Calédonie, en plein milieu du Pacifique, le sort des Polynésiens fut similaire à celui des Kanaks. Au moment de la prise de possession française, en 1842, les Polynésiens subissaient déjà dans leur chair les conséquences de la présence européenne depuis plusieurs décennies. Décimée par les maladies et subissant les ravages de l’alcool, la population polynésienne avait chuté brutalement. Sur l’île de Tahiti elle était passée de 70 000 habitants en 1760 à 9 000 en 1842.
Malgré cela les Tahitiens menèrent une résistance acharnée contre l’invasion française. En arrivant, les officiers français destituèrent la reine Pomaré, confisquèrent ses terres, arrêtèrent les chefs et exigèrent une rançon en menaçant de la guerre. Durant 3 ans, 4 000 combattants, la moitié de la population, tinrent en échec une armée bien plus équipée qui dut mobiliser l’ensemble de sa flotte du Pacifique pour finalement les soumettre.
À la différence de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie n’était pas initialement destinée à devenir une colonie de peuplement mais une base militaire. Mais à partir des années 1860 et de la guerre de Sécession américaine, l’envol du prix du coton ouvrit les appétits d’entrepreneurs venus d’Europe et entraîna la mise en culture de productions tropicales autour de Tahiti. Les conquérants européens, pour reprendre les mots de Rosa Luxembourg, ne se proposaient pas uniquement d’asservir et d’exploiter économiquement les indigènes, mais arrachaient de leurs mains leur moyen de production le sol. L’administration mit à la disposition d’entrepreneurs des milliers d’hectares confisqués aux Tahitiens. Par exemple, 3 000 hectares furent concédés à Atimaono sur l’île de Tahiti à un commerçant écossais pour des plantations de café, coton et canne à sucre. 1 500 ouvriers y travaillaient, des centaines de Tahitiens et de Polynésiens des autres îles se mêlaient à des centaines de travailleurs provenant des Îles Cook, des Kiribati britanniques, situées à plusieurs milliers de kilomètres et même de la Chine à près de 10 000 km de la Polynésie. Pour aller les chercher, les planteurs engageaient des recruteurs qui pratiquaient le blackbirding (la traite des oiseaux noirs), une pratique digne de la traite négrière ils achetaient des cargaisons de travailleurs à des armateurs anglais qui les avaient arrachés de force à leur terre d’origine. Ils étaient vendus aux planteurs pour plusieurs années. Ces travailleurs allaient constituer un premier prolétariat agricole auquel allait s’ajouter bientôt un nouveau prolétariat industriel.
Dans les années 1880, la France étendit sa présence en Polynésie comme ailleurs sur le globe. Le capitalisme connaissait à ce moment une nouvelle évolution. Banquiers et capitalistes européens avaient amassé des masses considérables de capitaux qu’ils voulaient faire fructifier.
En rivalité entre elles pour s’emparer des marchés et des matières premières, s’appuyant sur leurs États respectifs, les bourgeoisies européennes, devenues impérialistes, s’engagèrent dans une course de vitesse pour se partager le globe. L’Océanie était aussi l’objet de toutes les convoitises. L’Allemagne, puissance montante en quête de colonies, était venue perturber le partage à l’amiable des archipels du Pacifique entre la France et la Grande-Bretagne : l’Allemagne prit le contrôle de la Papouasie, des Samoa et des îles Salomon. Menacée par ses concurrents, la bourgeoisie française s’organisa pour y renforcer sa présence.
En Polynésie, elle colonisa plus d’une centaine d’îles et atolls parfois éloignés de plusieurs milliers de kilomètres et les regroupa dans un vaste ensemble politique qu’elle appela Établissements français d’Océanie (EFO).
Pour soumettre la population polynésienne la France eut de nouveau recours à la force. En 1887, sur la petite l’île de Raiatea proche de Tahiti, 800 hommes, soit un tiers de la population s’organisèrent derrière un des chefs de clans, Teraupoo, qui rallia l’ensemble des clans de l’île pour mener la résistance Il fallut dix ans à l’armée française pour les vaincre malgré sa supériorité technique. Teraupoo, fut condamné à dix ans de bagne en Nouvelle-Calédonie. Quand ce ne fut pas l’armée, ce furent les curés qui intervinrent. Grâce à la présence de missionnaires catholiques qui réglaient depuis plusieurs décennies déjà la vie civile et religieuse des habitants, l’impérialisme français prit possession des îles Gambier situées à 1 500 km au sud-est de Tahiti.
Après les curés et les militaires vinren les juristes. Dès la fin des années 1880, du phosphate avait été découvert sur l’île de Makatea à 220 km au nord de Tahiti. Appuyé par des notaires, des magistrats et des avocats, l’ingénieur Touzé, qui avait découvert le gisement, fit signer 1 200 contrats de vente aux propriétaires de l’île pour obtenir leur terre à des prix dérisoires, dépossédant ainsi des centaines de familles. Touzé fonda la Compagnie française des phosphates d’Océanie (CFPO). Elle exploita la mine entre 1908 et 1966, arracha 11 millions de tonnes de phosphates en y faisant trimer des milliers de Chinois, de Japonais, d’Indochinois en plus de tous les Océaniens qu’elle fit venir des myriades d’îles entourant la Polynésie. Une bonne partie des ouvriers participèrent plus tard à la construction du centre d’expérimentation nucléaire.
En leur volant leurs terres, le capitalisme européen avait sapé la base de l’ancienne organisation sociale des Polynésiens. Ils furent forcés de se fondre dans la société coloniale. Pour assurer la gestion générale de la société, l’administration laissa subsister les chefs coutumiers en les assimilant à de petits fonctionnaires ce qui leur permettait de recevoir une écharpe tricolore mais pas grand-chose de plus. L’intégration de ces chefs permettait de canaliser les conflits tout en maintenant la soumission de la population.
En même temps, le pouvoir interdisait à la population la pratique de la langue tahitienne, et l’obligeait à participer aux fêtes patriotiques françaises. Il put pour cela s’appuyer, comme souvent, sur la religion, les écoles catholiques et protestantes ayant le monopole sur l’éducation.
Colons et polynésiens se marièrent. Le métissage fut aussi un puissant moyen pour les colons d’assurer leur domination sur l’île. Victor Raoulx, un marin français devenu riche négociant et possesseur de champs de canne à sucre à Tahiti à la fin du 19e siècle se maria avec une fille de propriétaire polynésien de Moorea. Il put ainsi s’intégrer dans les milieux des chefferies tahitiennes tout en trustant les positions de pouvoir dans l’administration coloniale. Ses enfants métis, des « demis », devinrent à leur tour des membres influents de la petite bourgeoisie locale, à cheval entre la société coloniale et la société polynésienne. Au début du 20e siècle cette population de demis fut le plus fidèle soutien de l’administration coloniale. Elle les promut à des postes de direction administrative tout en les soutenant dans leurs affaires. Les demis lui devaient ainsi leur position sociale et le pouvoir put s’appuyer sur eux pour imposer sa présence.
La Réunion et le prolétariat de la canne
À douze mille kilomètres de la Polynésie, la concurrence entre les puissances européennes pour contrôler les îles de l’océan Indien était tout aussi âpre. La seule île conservée par la France après les guerres napoléoniennes, La Réunion, était aux mains de colons, propriétaires fonciers enrichis grâce aux plantations de canne à sucre et aux usines sucrières.
Leurs affaires ne furent aucunement bouleversées par l’abolition de l’esclavage en 1848, remplacé, comme en Nouvelle-Calédonie, par « l’engagisme ».
Entre 1860 et 1885, de 3 000 à 5 000 Indiens furent « engagés » chaque année à La Réunion, aux côtés de milliers d’Africains, de Comoriens, de Yéménites et de Malgaches qui partageaient leur sort. Les engagés étaient sous contrat pour une durée de cinq ans en général. Théoriquement libres avant de s’engager, nombreux étaient ceux qui en réalité étaient achetés à des marchands d’esclaves qui les faisaient venir à La Réunion dans des conditions à peine meilleures que celles des navires négriers. Ils étaient ensuite mis au travail dans des conditions similaires à celles des esclaves : mêmes camps, même système de commandement, mêmes horaires de travail à rallonge. La dernière composante du prolétariat réunionnais fut formée des petits blancs, qui partageaient la même misère que les descendants d’esclaves et que les engagés. Trop petits pour suivre le progrès technique et incapables de survivre à l’abolition de l’esclavage, ces petits blancs se sont souvent réfugiés dans les Hauts de l’île, à la limite des terres cultivables, vivant chichement mais librement, de chasse, cueillette et rapine, au grand dam des plus riches, qui les qualifiaient de « vermine rongeante pour la colonie ».
Mayotte… pour conquérir Madagascar
Si La Réunion faisait le bonheur des planteurs, Mayotte, située à mi-chemin entre le sud-est du continent Africain et Madagascar, occupait une position de premier plan sur le canal du Mozambique. Elle pouvait devenir une station militaire pratique en raison de ses rades immenses protégées par une ceinture de récif qui la rend facile à défendre.
La prise de contrôle de Mayotte à partir de 1841 fut réalisée sans guerre parce que le sultan de Mayotte, Andriantsoly, en difficulté face aux sultans des îles comoriennes voisine s’était placée sous la protection de la France. En contrepartie il lui cédait en « toute propriété » l’île de Mayotte qui devint ainsi une partie du Royaume de France. Cet épisode permet aujourd’hui aux notables mahorais de défendre la présence française tout en propageant une haine anti-Comoriens.
Sur Mayotte, le pouvoir colonial s’employa à en exploiter les richesses. Il soumit les populations à ses exigences accompagnées du même mépris qu’ailleurs. Les promesses de respect des propriétés des Mahorais, écrites noir sur blanc dans le traité du 25 avril 1841, signé avec le sultan lors de la prise de possession, furent rapidement bafouées. L’État français leur vola leur terre et en fit des concessions à des métropolitains et des Réunionnais. Sur le modèle de La Réunion, l’administration coloniale chercha à faire de Mayotte une île tournée vers la monoculture du sucre à partir de la fin des années 1840.
Dans sa recherche de main-d’œuvre à exploiter sur ses plantations, la bourgeoisie était bloquée. Le système esclavagiste en vigueur à Mayotte avant son arrivée la rendait indisponible. Aussi, pour pouvoir bénéficier de la main-d’œuvre locale, les possédants de Mayotte obtinrent de l’administration coloniale que l’esclavage fut aboli à Mayotte en 1847, un avant son abolition en métropole. Pas de question morale dans tout cela : puisque l’esclavage les privait de prolétaires, les capitalistes n’hésitèrent pas à le supprimer après l’avoir pratiqué à grande échelle dans d’autres colonies pour déporter la force de travail dont ils avaient besoin.
Comme à La Réunion, ils le remplacèrent par le système de l’engagement. Les planteurs français allèrent chercher de la main-d’œuvre dans les îles des Comores, à Zanzibar, en Afrique et jusqu’en Inde. Il n’est donc pas nouveau que des Africains, des Malgaches ou des Comoriens viennent à Mayotte. À l’époque ils étaient amenés par les colons, aujourd’hui ce sont les guerres ou la misère qui les chassent vers l’île.
Les conditions épouvantables de travail poussaient régulièrement à la révolte ces exploités. Des séries de mutineries ou d’abandons de plantations, ce qu’on appelle le marronnage, rassemblèrent des centaines d’engagés. L’une d’entre elles fut menée en 1856 par Bakary Koussou, un ancien propriétaire d’esclave humilié par le pouvoir colonial français, qui n’avait pas tenu ses promesses de protection de ses biens. Prenant la tête de la révolte des travailleurs qui désertèrent les plantations, arrêté comme six autres insurgés, il fut condamné à mort, exécuté sur la place publique de Dzaoudzi, alors capitale de Mayotte. Même si l’espoir de s’affranchir de la domination du colonisateur était mince, dans toutes les colonies, sur tous les continents, les esclaves se sont révoltés à de nombreuses reprises, refusant la soumission, montrant à ces occasions les trésors d’ingéniosité et de détermination dont ils étaient capables.
À partir de Mayotte, l’impérialisme allait organiser en 1895 sa conquête de Madagascar. Cette île continent de la superficie de la France, gorgée de richesses, et qui avait jusque-là réussi à éviter de devenir une colonie française ou anglaise allait être au cœur d’un sordide marchandage dont les puissances impérialistes sont coutumières. La France donnait son accord à la prise de possession de Zanzibar par l’Angleterre tandis que l’Angleterre acceptait la colonisation de Madagascar par la France.
Mais les habitants ne se laissèrent pas faire. La campagne de Madagascar fut des plus atroces. Les soldats français tombaient comme des mouches, décimés par la fièvre. Il fallut dix ans et le massacre de centaines de milliers de Malgaches, sur une population de 2,5 millions d’habitants, pour mater les révoltes qui ne s’arrêtèrent jamais vraiment. Cela n’empêcha pas la bourgeoisie française de commencer la mise en exploitation de l’île pour en récolter, le riz, le café, le sucre, les épices et le caoutchouc.
Le prolétariat des îles et le mouvement ouvrier
Au début du 20e siècle, l’impérialisme français avait établi sa position dans l’Océan Indien et dans le Pacifique. En envoyant des aventuriers, des soldats, des marchands, des prêtres, des juristes, avides de pillage, brutaux et hypocrites ces « civilisateurs » ont détruit des sociétés anciennes, exterminé, répandu la famine, exploité, vendu des millions d’êtres humains… À ce prix, ils ont fait émerger une classe d’opprimés faite de petits colons européens, d’engagés de toutes les nationalités et d’autochtones.
Pour citer Rosa Luxembourg, qui consacra des pages aussi émouvantes que scientifiques à cette introduction du capitalisme partout sur la planète « Le capital n’est pas qu’à sa naissance "dégouttant de sang et de boue par tous les pores" mais pendant toute sa marche à travers le monde ; c’est ainsi qu’il prépare dans des convulsions toujours plus violentes son propre effondrement ».
Avant elle, Marx et Engels avaient dénoncé la bourgeoisie anglaise colonisant les Indes, soumettant la Chine, maintenant sa domination sur l’Irlande. Ils avaient tracé une voie pour la révolte des peuples colonisés. Pour eux, le prolétariat des pays industrialisés pouvait, en renversant sa propre bourgeoisie, offrir une solution aux peuples colonisés.
Pour les militants communistes révolutionnaires, l’émancipation des opprimés des colonies et celle des prolétaires des métropoles impérialistes étaient indissociables.
Mais au tournant des 19e et 20e siècles, alors que les rivalités impérialistes déchiraient le monde, toute une partie du mouvement ouvrier voyait la colonisation comme une bonne chose. L’idéologie de la bourgeoisie pénétrait au sommet des organisations ouvrières et parmi l’aristocratie ouvrière. Ces organisations reprenaient les idées de « mission » civilisatrice de leur propre impérialisme espérant ainsi conserver leurs privilèges. Ainsi, au début du 20e siècle, les fédérations socialistes des Antilles, s’opposaient à toute idée de séparation des colonies d’avec la France.
En 1917, la Révolution russe et les bolcheviks avaient mis fin à l’oppression que l’Empire tsariste faisait subir à des dizaines de nationalités éparpillées sur un territoire immense. La révolte contre l’oppression nationale avait été un facteur décisif de cette révolution. En ouvrant les portes de la « prison des peuples » et en portant au pouvoir les opprimés sans distinction de nationalité les bolcheviks allaient ainsi offrir un programme à la fois aux peuples colonisés et aux militants communistes des pays impérialistes.
L’Internationale communiste, fondée en 1919 affirmait alors « Tout parti appartenant à la Troisième internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de "ses" impérialistes aux colonies, de soutenir non en paroles mais en fait tout mouvement d’émancipation dans les colonies, d’exiger l’expulsion des colonies des impérialistes de la métropole, de nourrir au cœur des travailleurs du pays des sentiments véritablement fraternels vis-à-vis de la population laborieuse des colonies et des nationalités opprimées et d’entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation continue contre toute oppression des peuples coloniaux ».
Dans les pays colonisés, l’Internationale communiste fixait comme objectif de lutter pour l’émancipation nationale tout en conservant l’indépendance du mouvement prolétarien, « même quand il n’avait encore qu’une forme embryonnaire », car le prolétariat devait aussi se préparer à disputer, tôt ou tard, la direction de la révolution à la bourgeoisie nationale.
L’Internationale insistait sur « la nécessité de lutter contre la tendance à parer des couleurs du communisme les courants de libération démocratique bourgeois des pays dominés ».
Mais ce programme ne put être défendu réellement dans les colonies. Le stalinisme, qui gangrena en quelques années l’Internationale et les partis communistes, se dressa comme un nouvel obstacle sur cette voie, quand leurs peuples s’engagèrent après la Deuxième Guerre mondiale dans la voie révolutionnaire pour se libérer de l’oppression coloniale.
L’impérialisme français face aux aspirations anti-coloniales des peuples
À l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, la rage accumulée pendant des siècles d’oppression explosa et secoua l’ensemble des empires coloniaux. En Indochine, en Algérie et dans toute l’Afrique les peuples se soulevaient les uns après les autres en une puissante vague révolutionnaire, bousculant une bourgeoisie française affaiblie et déconsidérée.
Cette vague anti-coloniale toucha aussi les îles lointaines du Pacifique et de l’océan Indien. Dans ces îles, à l’exception de Madagascar, il n’y eut pas d’insurrections mais partout les peuples s’éveillaient et aspiraient à se libérer de la colonisation française.
Staline étant alors l’allié explicite des impérialistes occidentaux, les partis communistes étaient devenus les gardiens de l’ordre capitaliste. Dans les métropoles ces partis apportèrent leur soutien à leur propre bourgeoisie pour briser ces révoltes ou les emmenèrent dans des impasses.
En France, le PCF publia en 1944 une brochure intitulée Au service de la renaissance française. Il y expliquait « Pour la France, être une grande puissance européenne et mondiale et tout simplement continuer d’être, c’est la même chose […]. Unité et intégrité de la plus grande France, des Antilles à Madagascar, de Dakar à Casablanca, à l’Indochine et à l’Océanie. Notre pays est une puissance des cinq parties du monde et on ne découvre pas de raison pour laquelle il devrait cesser de l’être ».
Ce langage était l’opposé exact de celui de l’Internationale Communiste 25 ans plus tôt, à l’époque de Lénine.
Malgré tout, dans les colonies françaises, au sortir de la guerre, le prestige du parti communiste et de l’URSS demeurait vivace. Cela a conduit nombre de ceux qui se battaient pour leur liberté à se tourner vers des organisations liées au PCF. D’autres, repoussés par le soutien inconditionnel du PCF à l’impérialisme français, se tournèrent vers des organisations nationalistes.
Selon les pays, celles-ci affichaient un langage socialiste tout en n’ayant pas d’autres objectifs que l’indépendance et, au fond, celui de permettre l’accès des bourgeois locaux petits ou grands à une plus grande part des richesses et du pouvoir. Ainsi la révolte profonde et durable, l’immense courage et l’abnégation dont firent preuve les opprimés des colonies, les militants ou les intellectuels qui cherchaient une voie pour s’émanciper, restèrent sur le seul terrain nationaliste.
À Madagascar, la répression sanglante de l’insurrection contre l’ordre colonial
Alors que le PCF participait au gouvernement en France avec les socialistes et la droite, une puissante insurrection contre l’ordre colonial explosa à Madagascar en mars 1947. Les insurgés armés de sagaies et de coupe-coupe attaquèrent les postes de polices, les garnisons plusieurs gros colons furent tués. La révolte déferla sur toute l’île. L’état de siège fut décrété et l’impérialisme dépêcha un corps expéditionnaire de 30 000 soldats. Les troupes françaises ne reculèrent devant aucune atrocité pour mater l’insurrection : mutilations d’otages, mitraillages de trains, largages par hélicoptère de prisonniers vivants au-dessus de villages rebelles, incendies d’habitation. Cette répression sanglante fit, selon l’état-major, 89 000 morts soit 2 % de la population malgache. Elle fut si effroyable et fit disparaître tant de militants indépendantistes que la mémoire collective des Malgaches l’a occulté pendant 50 ans, la transformant en rumeur. En France, elle a été effacée aussi car ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire et que les partis de gauche alors au pouvoir ont voulu faire oublier leur complicité. Les députés du PCF votèrent la levée de l’immunité parlementaire des députés malgaches rendus responsables d’une insurrection qu’ils avaient condamnée. Le PCF refusa de rompre la solidarité avec le gouvernement pendant les massacres et cautionna les procès expéditifs qui suivirent l’écrasement de l’insurrection.
L’état de siège ne fut levé qu’en 1956 et en 1960 l’impérialisme français finit par concéder l’indépendance à Madagascar tout en plaçant à la tête de l’État Tsiranana, un homme qu’il avait choisi, pour pouvoir continuer à piller le pays.
La Réunion : le PCF organise la collaboration de classe
Pour garder le contrôle dans cette région, l’État fit de La Réunion un département en 1946, avec l’appui de représentants de la gauche locale. À La Réunion, le mouvement ouvrier avait pris son essor à partir de 1936, la grève générale qui paralysa la France métropolitaine ayant des répercussions jusque dans les colonies. Parmi ses premiers dirigeants, Léon de Lépervanche, militait pour l’amélioration des conditions de travail et pour le resserrement des liens avec la métropole. Une de ses banderoles revendiquait alors « La Réunion – département français ». Il faisait cause commune avec Raymond Vergès, un médecin proche de la Ligue des droits de l’homme, et tous deux furent élus députés de La Réunion. À l’Assemblée nationale, à la suite d’Aimé Césaire pour les Antilles, ils défendirent la départementalisation. Ils trouvèrent l’appui du PCF et en devinrent membres. S’ils se battaient légitimement pour que les travailleurs de La Réunion jouissent des mêmes droits que ceux de métropole, ils trahissaient les exploités en leur faisant croire qu’ils pouvaient placer leur confiance en un État qui était celui des classes possédantes qui colonisaient leur île depuis trois siècles.
Car si les représentants de la bourgeoisie française à l’Assemblée nationale se prononcèrent pour la départementalisation de La Réunion en 1946, c’était par crainte des mouvements de colère de la population pour qui la situation au sortir de la guerre était intenable. Cette loi lanterna les travailleurs : l’application à La Réunion des lois de la métropole se fit sur des décennies. Il fallut attendre cinquante ans pour que le smic réunionnais soit aligné sur celui de métropole. En revanche, la départementalisation fut très bénéfique aux grands propriétaires blancs qui comprirent tout l’intérêt que pouvait leur apporter ce rapprochement avec l’État français : celui-ci leur achetait un contingent annuel de sucre de canne à un prix largement au-dessus du cours mondial, tout en continuant à mettre à leur disposition des forces de répressions efficaces contre les ouvriers et les petites gens qui réclamaient leurs droits.
La fédération réunionnaise du PCF animée par Vergès et de Lépervanche réunissait tous ceux qui voulaient se battre pour améliorer leur sort. Aussi, face à l’amertume qui gagnait la population pauvre déçue des résultats de la départementalisation, elle changea de politique.
Elle devint en 1959 le PC réunionnais et fit la promotion de l’autonomie. Le PCR réclamait désormais le droit aux « Réunionnais » de gérer leurs affaires mais c’était toujours une politique de collaboration entre les classes ; il offrait désormais aux classes possédantes de l’île de gérer avec elles les intérêts « réunionnais ». Le PCR et ses militants eurent néanmoins à subir dans les années 1960 bien des attaques de la part des possédants, des partis de droite et de l’administration qui les accusaient de vouloir détacher l’île de la métropole. Le PCR apparaissait ainsi radical et maintint son influence parmi les pauvres et les travailleurs malgré l’inefficacité de sa politique.
Pendant que le PCR élaborait des plans avec la bourgeoisie réunionnaise, le gouvernement français traitait toujours les Réunionnais en colonisés, organisant une véritable déportation de pauvres de La Réunion destinés à servir de main-d’œuvre en métropole. Entre les années 1960 et 1980, plus de 1 600 enfants furent arrachés à leurs familles pour aller servir de main-d’œuvre rurale. Au même moment, l’État mit sur pied le Bumidom, (le Bureau pour le développement des migrations intéressant les DOM). Il agissait en agent recruteur pour les grandes entreprises françaises, Michelin, Peugeot, SNCF, qui firent venir plus de 70 000 travailleurs réunionnais pour les exploiter dans leurs usines et ateliers.
Les Comores : l’impérialisme charcute les peuples
À Madagascar, la France perdit une de ses principales bases navales, celle de Diego-Suarez. Pour conserver une présence militaire dans le canal du Mozambique, Mayotte apparaissait comme la meilleure option.
Mais depuis les années 1960, aux Comores, la lutte pour l’indépendance s’organisait et après celle de Madagascar une nouvelle déconvenue menaçait l’impérialisme français dans l’océan Indien. Il usa des manœuvres les plus tordues pour l’éviter.
L’État français exacerba les rivalités entre les quatre îles des Comores, attisant la haine entre les habitants de Mayotte et ceux des autres îles. Il transféra la capitale du Territoire des Comores de Dzaoudzi (Mayotte) à Moroni (Grande-Comores).
Du jour au lendemain, la marasme économique s’installa à Mayotte et ses habitants durent faire face à l’arrogance des nouveaux fonctionnaires, après des dizaines d’années durant lesquelles Mayotte avait bénéficié d’un traitement plus favorable. La France donnait un avant-goût de ce qui attendait Mayotte si elle optait pour l’indépendance.
Pour alimenter le nationalisme franco-mahorais, elle pouvait s’appuyer sur les notables locaux, les grandes familles apeurées par la perspective de quitter le giron français. Pour eux cela signifiait que leurs possessions perdraient de la valeur, que leur petit pouvoir serait remis en cause. Autour de Marcel Henry et Younoussa Bamana, tous deux issus de familles de propriétaires terriens, des notables s’organisèrent au sein du Mouvement populaire mahorais (MPM) dont est issu l’actuel Mouvement pour le développement de Mayotte (MDM). Aidés par des militants de l’extrême droite monarchiste de métropole, nostalgiques de l’Empire colonial, ils menèrent la lutte pour ce qu’ils appelaient « Mayotte française ». Ils mirent sur pied des milices, les « chatouilleuses » et les « sorodas » pour chasser de l’île manu militari les militants pour l’indépendance appelés les « serrez-la-main ». Ils propageaient ainsi un nationalisme franco-mahorais violemment anti-comorien.
L’État français préparait le terrain à la séparation de Mayotte mais le pouvoir hésitait. La départementalisation de Mayotte était défendue par Michel Debré, député de La Réunion, proche de De Gaulle. En revanche, Jacques Foccart le Monsieur Afrique de De Gaulle, craignait une explosion de colère dans le cas d’une indépendance des Comores sans Mayotte. Il militait pour une indépendance fictive des quatre îles en manœuvrant en sous-main grâce à un chef d’État local à la botte de l’impérialisme comme il l’avait organisé bien des fois en Afrique.
Finalement l’impérialisme français joua sur les deux tableaux. Après bien des tergiversations, les représentants politiques de la bourgeoisie française décidèrent d’organiser un référendum sur l’indépendance, mais de prendre en compte les résultats île par île, piétinant les règles du « roit international que l’État français ne cesse de prétendre défendre. Après que les milices pro-françaises eurent fait le ménage, intimidant tous ceux qui souhaitaient l’indépendance, les électeurs de Mayotte se prononcèrent en 1976 à 99 % pour rester français tandis que dans le reste des Comores l’indépendance l’emportait.
Pourtant, le gouvernement n’était pas encore disposé à faire de Mayotte un département. Il la dota d’un statut de collectivité particulier donnant surtout des pouvoirs élargis au préfet. La petite bourgeoisie mahoraise, bien mal récompensée par les maîtres à qui elle voulait lier son sort, allait devoir encore patienter 35 ans.
Au même moment, le dirigeant du territoire des Comores, Ahmed Abdallah, proclama son indépendance. Une indépendance qui allait vite se révéler de pure forme. Les Comores allaient devenir le terrain de jeu des barbouzes menés par Bob Denard et des diplomates français pendant plus de 20 ans. En privant les Comores des quelques subsides qu’il lui octroyait, l’État français allait condamner la population comorienne à une situation de pauvreté parmi les plus dramatiques de la région.
En menant ces manœuvres, la France réussit le tour de force de diviser un peuple dont les liens culturels, familiaux et économiques étaient séculaires. En 1995, la division fut approfondie et entérinée juridiquement lorsque le gouvernement Balladur instaura un visa pour pouvoir circuler des Comores à Mayotte. Il transformait ainsi les pauvres des îles de l’archipel des Comores en immigrés clandestins obligés de risquer leur vie sur des embarcations de fortunes pour rejoindre Mayotte. La remise en cause actuelle du droit du sol et les discours xénophobes qui l’accompagnent sont le produit de la politique de domination de l’État français qui met les peuples dans une situation absurde et invivable.
La vie des peuples d’Océanie chamboulée par la Deuxième Guerre mondiale
En Océanie, le passage de l’armée américaine sur leurs îles pendant la Deuxième Guerre mondiale bouleversa la vie des populations. En Nouvelle-Calédonie, des centaines de milliers de soldats débarquèrent accompagnés de toute la technologie moderne mais aussi d‘emplois payés en dollars bien loin du travail forcé de l’indigénat. En Polynésie, l’île de Bora-Bora fut couverte d’infrastructures dernier cri pour accueillir les avions gros-porteurs américain.
Une partie de la population océanienne a pu constater à quel point l’État français la laissait vivre dans des conditions arriérées. Au contact des soldats venus des pays impérialistes, ils fréquentèrent des noirs américains, des militants de tout bord, découvrant les idées d’émancipation sociale et nationale. Pour leur faire accepter les sacrifices de la guerre, le pouvoir colonial avait promis de leur assurer l’égalité. Les promesses furent oubliées par les colons, pas par les peuples colonisés.
La soumission des Polynésiens pour tester la bombe
En Polynésie, la contestation s’exprima autour de Pouvana’a a Oopa. Ancien combattant tahitien de la Première Guerre mondiale, il a pris conscience des injustices que subissaient les Polynésiens. Durant la Deuxième Guerre, il enragea contre les privilèges des fonctionnaires français alors que les Tahitiens manquaient de tout. Il ne cessa de mobiliser la population contre l’administration française. Pourchassé, arrêté, condamné, Pouvana’a devint très populaire parmi les pauvres, les ouvriers et les paysans de Polynésie et se fit élire député en 1949. Bien qu’il se défendît publiquement d’être communiste, le PCF décida de le soutenir.
Le PCF avait renoncé à construire des Partis communistes dans l’empire colonial pour mettre sur pied des partis dits « démocratiques » qui prônaient l’assimilation à la métropole. En Polynésie, il construisit autour de Pouvana’a le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes (RDPT). Comme à La Réunion, le PC français conduisait les opprimés non pas à combattre l’impérialisme mais à placer leur confiance en son État. Pouvana’a, lui, évoluait vers les idées d’indépendance. Il se rendait compte que rien ne changeait et devint l’homme à abattre, pour l’État français. En 1958, le pouvoir gaulliste monta de toutes pièces une accusation mensongère contre lui. Il fut condamné à 8 ans de prison en métropole, et à 15 ans d’interdiction de séjour en Polynésie.
À cette période, la course à l’arme nucléaire était engagée par les grandes puissances. L’impérialisme français cherchait un site pour réaliser les essais. Le Sahara algérien avait la préférence de l’État qui y fit exploser 17 bombes entre 1960 et 1966. Mais dans la perspective de sa défaite face à la guerre menée par le FLN avec le soutien de la population algérienne, il se rabattit sur son second choix, la Polynésie.
Pour pouvoir y mener ses essais tranquillement, l’État français fit la chasse aux potentiels contestataires et chercha à bâillonner la population.
La période des essais nucléaires entre 1966 et 1996 a bouleversé la vie de la Polynésie. Dans ce qui était devenu une sorte d’archipel de garnison, les inégalités ont explosé entre des fonctionnaires bénéficiant des salaires métropolitains et une couche de travailleurs aux petits salaires qui se sont entassés à Tahiti après avoir quitté leurs activités économiques traditionnelles.
Les 193 explosions nucléaires ont été une catastrophe sanitaire. Aujourd’hui encore l’espérance de vie en Polynésie est bien plus faible qu’en métropole, 6 ans de moins pour les femmes et 5 ans pour les hommes. Il y a deux à trois fois plus de cancers de la thyroïde qu’à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande.
À la fin des années 1970, des jeunes de la petite bourgeoisie polynésienne créèrent des organisations indépendantistes pour résister. La plus importante fut fondée par Oscar Temaru, un fonctionnaire des douanes, qui s’inspira de l’OLP palestinienne pour créer le Tavini, le parti aujourd’hui à la tête du gouvernement de la Polynésie.
Cette contestation politique posa un problème à l’État français qui sortit en 1984 la carte du statut d’autonomie en créant de nouvelles institutions locales. Elles lui permirent de constituer un réseau de politiciens locaux qui entretenaient toute une clientèle électorale favorable aux intérêts de l’impérialisme. Gaston Flosse, adversaire déclaré de l’indépendance, proche du RPR de Jacques Chirac, bénéficia de ces nouvelles institutions locales. Son métier d’assureur lui permit de se lier à tout ce que la Polynésie comptait de notables. Ses amitiés politiques, la corruption, le clientélisme lui permirent de régner pendant quarante ans sur la vie politique de l’archipel.
L’activité nucléaire fut une manne pour la petite bourgeoisie locale, qui profita des fonds qui arrivaient dans le Pacifique. Mais elle n’a permis aucun développement économique. En 1987, les dockers déclenchèrent une grève sur le port de Papeete pour obtenir une augmentation du nombre de manutentionnaires sur le site du centre d’expérimentation nucléaire de Mururoa.
La grève se transforma en émeute mobilisant toute la population pauvre de la ville. Durant les années 1990, de telles émeutes se succédèrent, la population dressant des barrages, brûlant des drapeaux français. La colère fut décuplée lorsque Chirac annonça la reprise des essais nucléaires en 1995 après trois ans d’arrêt. Les jeunes et les pauvres de Papeete prirent d’assaut l’aéroport pour empêcher les chefs politiques de l’île, dont Gaston Flosse, de quitter Tahiti. Ils affrontèrent pendant deux jours gendarmes et policiers.
Oscar Temaru et son parti, qui n’étaient pas à l’origine de la révolte, s’en firent les porte-parole, parlant au nom des jeunes et des pauvres qui n’avaient pas d’organisation, appelant au calme et aux élections. À la suite de ces émeutes, la popularité des indépendantistes s’accrut. L’État s’empressa de leur faire une place dans les institutions locales dont il élargit le nombre de postes et les compétences. En s’appuyant ainsi sur la colère de la population, les notables polynésiens, tout en maintenant une posture d’opposants se sont complètement intégrés au jeu des institutions bourgeoises.
Le massacre des Kanaks et l’intégration de leurs chefs pour tenir dans le Pacifique
La fin de la Deuxième Guerre mondiale accéléra de la même façon l’éveil des revendications politiques kanakes. Certains se rapprochèrent de militants syndicaux, surtout implantés dans le milieu européen des petits planteurs et des ouvriers blancs des mines, qui allaient fonder en Nouvelle-Calédonie un parti communiste à la sortie de la guerre.
Malgré l’hostilité de bon nombre de militants blancs, Jeanne Tunica, une Européenne patronne de bar, organisa en 1946 au sein du PC calédonien les travailleurs kanaks et indochinois, qui purent ainsi se battre contre le travail forcé et les inégalités salariales, l’abolition de l’indigénat et des impôts spécifiques. Mais le nationalisme du PCF contribua à jeter les Kanaks dans les bras de notables qui se firent les porte-parole des revendications nationales kanaks. Ceux-ci créèrent, en lien avec les missions catholiques et protestantes, le premier parti politique nationaliste, l’Union Calédonienne (UC).
Dans un premier temps le gouvernement lâcha du lest. L’indigénat fut aboli, le droit de vote progressivement attribué à tous les Kanaks. Mais très vite, il resserra la vis. En 1964, l’État français, emprisonna le leader de l’UC, Maurice Lenormand, un intellectuel pourtant modéré, en inventant une complicité d’attentat. Pour bâillonner les aspirations nationales des Kanaks, le ministre Pierre Messmer décida en 1972 de faire venir des personnes des autres territoires d’outre-mer – La Réunion, Wallis-et-Futuna, Polynésie… –, mais aussi de métropole, afin de diluer la proportion des Kanaks.
Les efforts de l’impérialisme ne parvinrent cependant pas à briser la combativité des Kanaks. Lors de la grève de Mai 1968, les Kanaks étudiant en métropole avaient découvert le marxisme et les luttes anticoloniales. Mais des versions frelatées du marxisme, le stalinisme et son avatar maoïste alors à la mode, dans lesquelles l’internationalisme et la lutte de classe étaient remplacés par le nationalisme. Ils fondèrent des partis comme le Palika (Parti de la libération kanake), tenant une position plus résolue pour l’indépendance, qui devint un concurrent de l’UC.
L’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, fit naître l’espoir de voir les revendications nationales kanakes satisfaites, mais très rapidement, ce fut la douche froide. Bien que le ministre de l’Outre-mer de Mitterrand affirmât le « droit inné et actif à l’indépendance », il rejeta la revendication des indépendantistes de permettre à la population kanake de se prononcer sur la séparation avec l’État français. C’était un nouvel affront. Les Kanaks décidèrent alors de boycotter les élections territoriales de 1984. Pendant plusieurs semaines, les militants couvrirent l’île de barrages routiers. Éloi Machoro, un des dirigeants nationalistes les plus radicaux au sein de l’UC, brisa une urne à coups de tamiok, une hache de guerre kanake. Il organisa le siège de Thio, la ville qui abritait la société Le Nickel en neutralisant et ridiculisant gendarmes et propriétaires caldoches. Les partis nationalistes se regroupèrent au sein du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) dirigé par Jean-Marie Tjibaou, un ancien prêtre, dirigeant de l’UC.
Mais très vite des dissensions apparurent. Lorsqu’Edgar Pisani, un émissaire du gouvernement proposa des concessions sur les institutions locales, Tjibaou, comme la plupart des dirigeants du FLNKS, appela à lever les barrages et à la discussion, alors même que deux de ses frères et dix militants du KLNKS venaient d’être assassinés dans une embuscade à Hienghène. Éloi Machoro et les siens proclamaient au contraire ne faire aucune confiance au gouvernement et appelaient à poursuivre le combat. Au fond Machoro partageait le même objectif politique que Tjibaou, arracher une plus grande part du pouvoir à l’impérialisme. Mais pour forcer l’État français à composer, il était prêt à user de méthodes radicales. C’est ce qui fit de lui l’homme à abattre.
En janvier 1985, il y a 40 ans, il fut, sur ordre de Pisani et probablement du gouvernement socialiste, abattu avec un autre militant par le GIGN alors qu’ils négociaient leur reddition.
Pendant les trois années qui suivirent, manifestations, barrages, affrontements armés se succédèrent. Une fois de plus, les Kanaks se battaient contre la puissance coloniale, que son gouvernement fut entre les mains de la gauche ou de la droite. En avril 1988, en pleine campagne des élections présidentielles, le socialiste Mitterrand étant à l’Élysée, pour faire pression sur l’État français, les indépendantistes attaquèrent une gendarmerie sur l’île d’Ouvéa. Les Kanaks tuèrent 5 gendarmes pendant l’assaut et en prirent 19 en otages. Puis, ils se réfugièrent dans une grotte. Le ministre Pons ordonna de mettre l’île en état de siège et choisit de faire donner l’assaut par l’armée qui anéantit les combattants indépendantistes, en tua 19, certains après l’attaque dans des exécutions sommaires. Pons fit consciemment le choix d’un tel massacre. Cela ne l’empêcha pas d’affirmer qu’il était du côté de ceux « qui ne veulent plus de violence ».
Une fois de plus, 40 ans après les massacres de Madagascar ou de Sétif, les dirigeants politiques français, gauche et droite à l’unisson, étaient prêts à massacrer les peuples coloniaux qui osaient relever la tête et refusaient de continuer à être traités en parias !
Après le massacre d’Ouvéa, Jean-Marie Tjibaou devint l’interlocuteur privilégié du gouvernement. Main dans la main avec Lafleur, le représentant de la droite caldoche descendant de colons, il signa les accords de Matignon en 1988.
Des dizaines de jeunes kanaks révoltés étaient morts, des dizaines d’autres avaient tout perdu pour se libérer de la colonisation française mais Tjibaou troqua leur combat contre quelques miettes de pouvoirs locaux.
Cet aboutissement n’était pas lié à la personnalité de Tjibaou mais au terrain choisi par les fondateurs du FLNKS : se battre pour la seule perspective d’arracher à l’impérialisme français quelques concessions qui ne menaçaient pas ses intérêts, d’arracher quelques postes pour gérer les richesses de la Nouvelle-Calédonie, sans chercher à entraîner les exploités de toutes les nationalités qui vivaient sur l’archipel ni ceux qui subissaient les mêmes spoliations, ségrégations et humiliations sur les autres îles et archipels du Pacifique.
L’impérialisme intégra dans les institutions une partie de la petite bourgeoisie kanake tout en préservant les positions de la bourgeoisie française et caldoche. À l’exception des pouvoirs régaliens (police, armée, justice, monnaie) les autorités locales, provinces, communes, obtinrent une large autonomie. Le pouvoir accordait en outre le gel du corps électoral qui réservait le droit de vote pour les élections et les référendums locaux aux habitants de la Nouvelle-Calédonie ayant une certaine durée de résidence sur l’archipel. Cela favorisait un peu les Kanaks tout en les laissant minoritaires. Depuis les accords de Nouméa de 1998 la Nouvelle-Calédonie est divisée en trois provinces. Celle du Sud, la plus riche et la plus peuplée avec Nouméa est aux mains des Caldoches anti-indépendantistes, les deux autres, celles du Nord et des îles Loyauté, les plus pauvres, sont dirigées par les partis kanaks. Dès lors, la vie politique de la Nouvelle-Calédonie est rythmée par le rapport de force entre l’État, la droite caldoche et les partis indépendantistes. Entre ces deux camps, il n’y a donc pas, malgré le passé colonial, de fossé de classe mais une concurrence pour le pouvoir local.
Dans l’océan Indien comme dans l’océan Pacifique, dans les décennies qui ont suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les peuples se sont à plusieurs reprises soulevés contre la domination de l’impérialisme français. Mais les travailleurs et les pauvres des îles n’ont trouvé comme drapeau derrière lequel se ranger que celui des notables nationalistes, qu’ils se disent autonomistes ou indépendantistes.
Aujourd’hui, alors que l’économie mondiale est en crise, la domination de l’impérialisme provoque de nouvelles crises politiques et de nouvelles révoltes. Les récents coups de colère en Nouvelle-Calédonie, la montée des tensions entre pauvres à Mayotte sur fond de misère croissante montrent à la fois le caractère explosif de la situation, le danger de la division entre opprimés et la nécessité de faire exister une politique qui se place sur un terrain de classe et pas sur le terrain nationaliste.
Aujourd’hui, l’impérialisme français se comporte toujours en puissance coloniale
Une puissance de seconde zone qui cherche à tenir son rang
Cette région du monde, l’indo-pacifique, comme journalistes et diplomates l’appellent désormais, est devenue le centre de toutes les attentions, en particulier pour endiguer l’influence de la Chine.
Si la France est incomparablement plus faible que les États-Unis, elle compte rester dans le jeu. Elle y possède le deuxième dispositif militaire dans la région, 7 000 militaires répartis dans ses différentes possessions. Y sont positionnés en permanence une douzaine de navires de guerre et une quarantaine d’aéronefs, et la DGSE y dispose d’un système de renseignements pour mener ses missions d’espionnage.
Parmi les intérêts économiques de la bourgeoisie française, il y a les vastes espaces maritimes que ses possessions des îles et des archipels lui permettent de contrôler, les Zones économiques exclusives (ZEE) qui s’étendent jusqu’à 370 kilomètres autour de toutes les côtes. 93 % de ces zones se situent dans les océans Indien et Pacifique, où abondent zones de pêches et ressources minérales : fer, zinc, cuivre, manganèse, cobalt, platine et terres rares. Le canal du Mozambique où se situent Mayotte et les îles éparses possédées par la France fait l’objet de toutes les attentions depuis une quinzaine d’années. D’abord parce qu’il est un des principaux lieux de passage du commerce mondial, mais aussi parce que depuis 2010 d’immenses gisements d’hydrocarbures y ont été découverts, dont les réserves sont estimées de 6 à 12 milliards de barils de pétrole et 5 000 milliards de mètres cubes de gaz. Ils suscitent les convoitises des grands groupes pétroliers mondiaux, TotalEnergies en tête. C’est aussi pour cela que l’impérialisme français a renforcé sa présence en faisant de l’île de Mayotte, dont la souveraineté est contestée par les Comores, un département français en 2011.
La Nouvelle-Calédonie possède d’immenses gisements de nickel qui représentent environ 25 % des réserves mondiales de ce minerai. Malgré la chute récente des cours, le nickel demeure recherché par les grandes puissances en raison notamment de son utilisation pour la fabrication des batteries de voiture électrique.
Voilà aussi pourquoi l’impérialisme français s’accroche, encore et toujours, à ses colonies. Mais il veut le faire à moindres frais, avec ou sans l’assentiment des peuples. Dans cette période de crise, cela lui pose de multiples problèmes politiques.
Mayotte : gouvernement français et petite bourgeoisie mahoraise organisent la guerre entre pauvres
En faisant de Mayotte un département français, l’État donnait un nouvel os à ronger aux notables qui le réclamaient depuis 1976, consolidant ainsi les liens qu’il avait noués avec eux. Leurs descendants ont aujourd’hui pris le relais, comme Anchya Bamana, fille de Younoussa Bamana, un des fondateurs du MPM, élue députée RN en juillet 2024.
Quinze ans après la départementalisation, la désillusion est forte pour ceux qui espéraient qu’elle améliorerait le niveau de vie des pauvres et des travailleurs. Mayotte est le plus pauvre de tous les départements français. Le chômage y frappe 34 % de la population active et la moitié des 310 000 habitants vivent avec moins de 260 euros par mois dans une île où le coût de l’alimentation est 30 % plus élevé qu’en France. Les infrastructures sont toutes sous-dimensionnées. Un tiers de la population n’a pas accès à l’eau courante ; pour les autres, l’eau est régulièrement coupée et n’est pas toujours salubre. Plus de 100 000 habitants sont aujourd’hui obligés de survivre dans des cases en tôles qui forment les plus grands bidonvilles de France.
Si Mayotte atteint des records de misère par rapport à la France, c’est un îlot de prospérité dans la région. Son PIB par habitant est dix fois plus élevé que celui des Comores et atteint vingt-cinq fois celui de Madagascar. L’État français a fabriqué un océan de misère autour de Mayotte.
Ces bidonvilles concentrent tous ceux qui souhaitent y échapper. Ils sont aussi remplis de personnes qui, tout en ayant la nationalité française, vivent dans les mêmes conditions. La communauté d’intérêts entre les opprimés de l’île, qu’ils soient étrangers ou français, saute aux yeux. Après la dévastation causée par le cyclone Chido en décembre 2024, ce sont tous les pauvres des bidonvilles, français ou étrangers, que l’État a laissé crever. Pour faire face, ils n’ont pu compter que sur leur solidarité, bien vivante, celle de leurs voisins et des travailleurs qui ont réparé les infrastructures ou soigné les blessés sans se préoccuper de la nationalité de ceux qu’ils aidaient. Non le racisme et la xénophobie ne sont pas le fait de la population mais le résultat d’une politique, celle de l’État français, un État colonial.
Pour tenter de masquer l’incurie de l’État dans la gestion de la catastrophe, tous les politiciens, de Macron à Bayrou en passant par Le Pen, ont mis en avant l’immigration comme source des maux de Mayotte. Les attaques et les expulsions ont repris quasi immédiatement. Ils exonéraient ainsi les capitalistes français qui, eux, profitent de Chido pour se remplir les poches. Les groupes Hayot et Sodifram, qui se partagent la grande distribution, ont vendu à prix d’or les bouteilles d’eau vitales pour la population. Les millions promis pour la reconstruction iront enrichir des trusts comme Colas pour les travaux publics ou Vinci pour le réseau d’eau qu’il laisse à l’abandon depuis tant d’années. Tous les pauvres et les travailleurs, français comme étrangers, avec ou sans papiers, subissent le racket de ces parasites.
En réprimant les étrangers, l’État ne cesse d’alimenter les divisions entre pauvres. En 2023, le ministre Darmanin a organisé l’opération Wuambushu, mobilisant des milliers de gendarmes et de policiers pour détruire des centaines de cases de bidonvilles et expulser des milliers de pauvres. Cette opération prétendait s’attaquer aux bandes de jeunes qui agressent les habitants, cambriolent les maisons, des violences que subissent effectivement tous les travailleurs. Mais elle a pour but d’assimiler délinquance et immigration alors que les jeunes armés de machettes de ces bandes sont aussi bien mahorais que comoriens. La violence et la naissance de ces gangs sont avant tout le produit de la misère qui frappe les enfants des bidonvilles.
Elles sont aussi le produit du durcissement des politiques anti-immigrés qui isolent les enfants lorsque leurs parents sont expulsés. Ils sont près de 10 000 à devenir ainsi la proie des gangs.
Pour mener à bien sa sale politique, outre les représentants de l’appareil d’État, la France peut compter sur les politiciens locaux qui jettent en permanence de l’huile sur le feu. La députée Estelle Youssouffa, une centriste, n’hésite pas à traiter les jeunes d’origine comorienne de « barbares en culottes courtes ». Elle est une des représentantes de cette partie de la petite bourgeoisie mahoraise, qui rêvait de se faire une place grâce à la départementalisation mais qui, voyant ses espoirs douchés, a tourné sa colère contre les immigrés. Durant les mobilisations de 2016-2018, elle s’est organisée en collectifs citoyens et a formé des milices, pour interdire aux étrangers l’entrée des dispensaires, bloquer l’entrée de la préfecture pour empêcher le renouvellement des titres de séjour, sous l’œil complaisant de l’État. Ce sont eux qui ont été à la base des « Forces vives » constituées lorsque la colère a de nouveau éclaté en 2024. Ces milices ont bloqué les routes, contrôlé les papiers, jusqu’aux entrées des HLM et dans les ambulances, pour s’assurer qu’ils étaient bien réservés aux Français. L’évolution du vote RN, passant de 2,7 % en 2012 à 59 % au deuxième tour de l’élection présidentielle de 2022 est le reflet de cette poussée de la haine anti-immigrés au sein de la petite bourgeoisie qui a aussi réussi à gagner une fraction des travailleurs à ses idées.
C’est bien là le principal danger. Ces idées poussent sur le terreau de la dégradation de la vie quotidienne et du fait de l’absence de toute autre politique pour les travailleurs. Au lieu de les combattre, syndicats et partis de gauche alimentent cet emballement xénophobe et nationaliste. Ainsi, le secrétaire départemental de la CGT Mayotte, Haoussi Boinahedja, un des représentants des Forces Vives, a repris l’idée dans les médias d’« une immigration d’appropriation, car l’État comorien revendique notre territoire ». Il a abandonné ainsi la moitié des travailleurs de l’île et rangé l’autre moitié derrière l’État français. Yasmina Aouny, la candidate LFI est sur la même ligne. Devenue une des porte-parole des collectifs citoyens anti-immigrés elle dénonce « l’arme démographique qui fait imploser le territoire ».
À Mayotte, la colère s’exprime périodiquement pour revendiquer que les droits des habitants du département soient alignés sur ceux du reste du pays, mais c’est toujours pour les « rançais , résidents dans un département français que ces droits sont réclamés. Les travailleurs de l’île qui n’ont pas la nationalité française et qui subissent eux aussi des conditions de vie indignes sont ainsi d’emblée exclus.
Mayotte est une bombe à retardement. Si elle explose dans ce contexte, en l’absence de militants organisés qui affirment haut et fort que tous les travailleurs de l’île, quelle que soit leur origine, subissent la même loi du profit, les cadres politiques spéculant sur la xénophobie pourraient trouver des troupes parmi les travailleurs pour s’en prendre à ceux qui sont depuis des années désignés comme les responsables de la situation leurs voisins comoriens, malgaches ou congolais. Ce sera la guerre entre travailleurs. Voilà l’avenir sanglant auquel pourrait conduire la politique menée par l’impérialisme français dans la région depuis des décennies. Cela doit sonner comme un signal d’alarme là-bas comme ici.
La Réunion : du patriotisme économique réunionnais à la xénophobie
Avec Mayotte, La Réunion forme le poste avancé de l’impérialisme français dans le Sud de l’océan Indien et les 885 000 habitants de l’île vivent dans le département le plus pauvre de France après Mayotte et la Guyane. Le PCR, s’est transformé en gestionnaire des intérêts de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie locale. Lorsqu’il était à la tête de la région, ces dernières années, il a élaboré des plans pour le développement économique de l’île qu’aurait pu signer n’importe quel autre parti. Ils prévoyaient de multiples cadeaux aux patrons, des soutiens pour la création d’emplois ou des exonérations diverses. Cette politique est toujours celle du petit conglomérat de partis de gauche qui dirigent le conseil régional de La Réunion avec à sa tête l’ex-membre du PCR, Huguette Bello, brièvement proposée l’été dernier comme Première ministre par le Nouveau Front populaire.
Brandissant sans cesse le drapeau du patriotisme économique réunionnais, elle arrose les entreprises locales, tout en prétendant que la misère de l’île viendrait de l’ingérence de capitaux étrangers. Elle explique ainsi aux travailleurs qu’ils doivent se réjouir de se faire exploiter par des patrons réunionnais plutôt que par des patrons étrangers.
De la démagogie régionaliste à la démagogie xénophobe et anti-pauvre il n’y a qu’un pas. Il est franchi par les politiciens de tout bord. Bien que la population réunionnaise soit d’origines multiples, les politiciens spéculent sur la peur d’un glissement vers plus de pauvreté en alimentant les préjugés racistes visant en particulier les Mahorais. Le député LFI de La Réunion, Ratenon, accusant les Mahorais d’être responsables des violences à La Réunion, demande l’arrêt de la venue d’enfants mahorais sur l’île. Les Mahorais pauvres qui cherchent un avenir meilleur à La Réunion sont ainsi traités comme les Comoriens à Mayotte : fauteurs de troubles et indésirables. À La Réunion aussi la bourgeoisie prépare la guerre entre les pauvres et les partis de gauche soufflent sur les braises de la xénophobie.
La Polynésie : les indépendantistes au service du patronat local
En Polynésie, trente ans après la fin des essais nucléaires, le quart des 280 000 habitants de l’archipel vit dans la pauvreté. La vie est chère, les prix des produits alimentaires sont de 45 % supérieurs à ceux de la métropole. L’emploi est rare, près de 40 % de la population en âge de travailler est sans travail et la Polynésie n’a ni allocations-chômage ni minima sociaux. Mais pour les capitalistes français, la Polynésie a tout d’un petit paradis : les prix délirants des marchandises remplissent les poches du trust CMA-CGM, en situation de quasi-monopole dans le transport des marchandises, et ceux de Carrefour, qui contrôle 50 % de la grande distribution. Les centaines de travailleurs de la perle, bien souvent non déclarés, dont les salaires atteignent à peine 800 euros par mois sortent chaque année des millions de perles pour faire les beaux jours des capitalistes du luxe. Bernard Arnault peut ainsi vendre un collier LVMH avec une seule perle de Tahiti pour 3 200 euros.
La population n’a rien à attendre des indépendantistes du parti Tavini qui ont remplacé le politicien affairiste Flosse à la tête des institutions locales. S’ils font périodiquement de grandes déclarations contre la colonisation française devant les institutions internationales, ils sont tout aussi soucieux que les autres des intérêts du patronat local. Lorsque les 101 salariés de la société de BTP Interoutes furent licenciés en 2023, et que la question de la création d’un système d’assurance chômage se posait, la ministre indépendantiste du Travail polynésienne, pouvait affirmer qu’il n’en était pas question car « nous sommes tous chrétiens et pour nous on doit gagner notre pain à la sueur de notre front ». Ici ou dans les îles le mépris des travailleurs par la petite bourgeoisie ne connaît pas les frontières !
Pour accéder à la mangeoire, les notables locaux des îles cherchent les meilleures voies qui sont toutes des impasses pour la population. Il y a ceux qui se rangent derrière la France et réclament la départementalisation comme à La Réunion ou à Mayotte, ceux qui ont eu l’indépendance comme aux Comores et à Madagascar et en vivent sur fond de pauvreté du peuple, et il y a ceux, comme en Polynésie, qui prennent des postures indépendantistes faussement radicales. Ni les uns ni les autres ne représentent les intérêts des opprimés.
Bon nombre de Polynésiens ont de la famille en Nouvelle-Calédonie et les émeutes de 2024 ont été suivies de près. Là aussi la situation est grosse d’explosions sociales. Mais comme à La Réunion ou à Mayotte la petite bourgeoisie à la tête des institutions locales déverse sa xénophobie. Le ministre indépendantiste de l’Éducation, déplorant que la Polynésie « blanchisse » reprend explicitement le terme d’« invasion ». Dans un pays où le métissage est si important, où le propre président Polynésien, Brotherson, est lui-même un demi, descendant lointain d’une famille danoise métissée avec des Polynésiens, ces propos sont stupides.
Même situés à des milliers de kilomètres, les opprimés de Polynésie partagent un passé et un présent commun d’exploitation avec tous les pauvres et les travailleurs des autres îles de l’océan Indien et du Pacifique colonisées par la France. Ils enrichissent les mêmes exploiteurs. La CMA-CGM contrôle le transport des marchandises de Port-Louis à Papeete en passant par Nouméa, Vinci gère le réseau d’eau de Mayotte et construit les hôtels de luxe de Tahiti. Carrefour domine la distribution de nourriture dans tous les archipels. La bourgeoisie française unifie leurs travailleurs, c’est là que se trouvent les alliés des travailleurs polynésiens avec lesquels ils peuvent se regrouper derrière un même drapeau, celui des exploités.
La Nouvelle-Calédonie : le combat des Kanaks, un espoir pour tous les opprimés des îles
En Nouvelle-Calédonie, les descendants des colons blancs, les Caldoches, en particulier les plus riches, continuent à se comporter en maîtres de l’archipel. Ils concentrent entre leurs mains la richesse et le pouvoir. 80 % de l’économie de l’archipel est ainsi contrôlée par dix grands groupes familiaux calédoniens en majorité caldoches comme les Ballande ou les Lafleur. Les Kanaks représentent environ 41 % des 270 000 habitants de l’archipel : c’est la communauté la plus nombreuse mais partout, à l’école, dans l’emploi et le logement, ils sont traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Ils subissent l’arrogance et le racisme de Caldoches qui dans la même phrase peuvent les traiter quotidiennement de « sales kanaks » et de « bons à rien ». Mais ils partagent également une même vie d’exploitation avec des milliers de Wallisiens et Futuniens, descendants de Tahitiens, d’Indonésiens, de Vietnamiens, de Ni-Vanuatu, de Chinois, de Japonais, avec une foule de travailleurs et de pauvres d’autres nationalités issues des îles du Pacifique Sud, mais aussi avec des milliers d’Européens modestes dont les conditions de vie n’ont pas grand-chose à voir avec celles de la bourgeoisie caldoche. Dans l’archipel ils forment ensemble une force, celle d’un prolétariat moderne composé de 27 000 ouvriers et 33 000 employés, un tiers de la population adulte, dont quelques bastions autour du secteur minier.
Ces dernières années, les populations kanakes et océaniennes ont vu leurs poids relatifs augmenter dans les urnes. Les partis indépendantistes ont ainsi pu prendre la tête des institutions locales entre 2019 et 2024, en s’alliant avec le parti océanien. La droite loyaliste était en difficulté. Elle voyait les postes à responsabilité s’éloigner. Elle mit la pression sur le gouvernement, remit au goût du jour ses vieux discours colonialistes et racistes pour remobiliser ses troupes.
Elle obtint satisfaction quand le gouvernement décida de dégeler le corps électoral, ce qui lui fournissait plusieurs milliers d’électeurs acquis à sa cause.
Ce dégel du corps électoral a été vécu par les Kanaks comme une nouvelle insulte et en mai dernier, sa colère légitime a explosé. La mobilisation avait été préparée par les partis indépendantistes au travers de plusieurs manifestations, parmi les plus massives que la Nouvelle-Calédonie ait connues. Mais ces partis n’avaient pas prévu que des milliers de jeunes, kanaks ou non, échappant à tout contrôle, construisent des barrages routiers et les occupent nuit et jour, affirmant haut et fort leur haine d’un gouvernement qui a du sang kanak sur les mains, ainsi que leur rejet des institutions dans lesquelles la France a essayé de les enfermer.
Si les représentants des partis de droite loyalistes sont des adversaires déclarés des Kanaks, les petits bourgeois kanaks qui dirigent les partis indépendantistes ne représentent pas plus leurs intérêts. Une partie de ces dirigeants, ceux du Palika en particulier, se sont ouvertement désolidarisés des révoltés du 13 mai et des semaines qui ont suivi.
Mais tous laissent par exemple croire que si les Kanaks géraient eux-mêmes l’extraction et la commercialisation du nickel, ils pourraient être libres et indépendants. Cela faisait partie du marché que le FLNKS avait passé avec l’impérialisme et la droite caldoche en 1998 : pour continuer à négocier, il fallait qu’ils obtiennent la gestion d’une usine. C’est ainsi que fut mise sur pied la KNS (Koniambo Nickel SAS), dirigée par des indépendantistes mais pour moitié propriété du trust minier Suisse Glencore. Inaugurée en 2014 elle devait symboliser la possibilité pour les Kanaks de faire tourner l’économie à leur profit. Mais 10 ans plus tard, estimant qu’elle n’était pas assez rentable, Glencore a décidé de la fermer, condamnant au chômage les 1 200 travailleurs de l’usine et supprimant des centaines d’emplois dans la sous-traitance.
Les partis indépendantistes kanaks cherchent à s’insérer dans le marché capitaliste mondial. Mais l’exemple de la KNS démontre qu’ils ne peuvent le faire qu’aux conditions qu’imposent les trusts qui le dominent. Dans les faits leur politique conduit à remettre l’avenir des Kanaks entre les mains de ces trusts. C’est une impasse.
Car en Nouvelle-Calédonie comme en France, à Nouméa comme à Cholet, les seuls souverains ce sont les capitalistes, les actionnaires et les financiers, qui n’ouvrent ou ferment des usines qu’en fonction des profits attendus. Et en Nouvelle-Calédonie comme en France la seule force capable d’y faire face c’est la classe ouvrière.
Conclusion
Comme partout où il s’est immiscé, le capitalisme a fait naître dans les îles du Pacifique et de l’océan Indien un prolétariat. Quand elle n’a pas trouvé la main-d’œuvre suffisante sur place pour cultiver ses champs de canne, de coton, exploiter ses mines de nickel ou de phosphates, trimer sur les docks, bâtir ses infrastructures, ses installations militaires ou touristiques, la bourgeoisie a déplacé, déporté, de gré ou de force des populations noires, blanches, d’Afrique, d’Asie et de myriades d’îles isolées dans les océans. La bourgeoisie les a exploitées de toutes les manières possibles, les a soumis à tous les statuts possibles. Son État a constamment cherché à semer la division en leur sein mais malgré tout, bien des fois, les opprimés de ces colonies se sont battus avec détermination.
À travers ces luttes, ils ont pu manifester toute la dignité de peuples qui, malgré la disproportion des forces, refusent de se laisser soumettre sans réaction. Mais politiquement, ces luttes n’ont, au mieux, que permis à la petite bourgeoisie nationaliste des îles d’obtenir une parcelle du pouvoir local. Qu’ils aient prôné la départementalisation, l’indépendance ou toute autre solution, ils cherchaient la meilleure option pour se faire une place et une fois qu’ils l’ont obtenue, ils ont prêché la patience aux opprimés se faisant ainsi les relais de la domination de l’État français. Contrairement à ce que tous les nationalistes affirmaient et affirment encore, sous l’impérialisme, il n’y a pas bonnes solutions pour les opprimés au sein de ces minuscules territoires colonisés.
Le capitalisme a transformé la planète et l’a modelé à son image. Le socialisme ne se réalisera pas dans la seule Nouvelle-Calédonie ou dans les îlots de Polynésie. Le socialisme ne peut exister qu’en renversant d’un bout à l’autre de la planète l’impérialisme. Car la seule solution qui peut permettre de mettre fin au formidable déséquilibre dans la répartition des richesses, entre les métropoles impérialistes et le reste du monde, né de siècles d’exploitation, c’est la mise à la disposition de toute l’humanité de l’ensemble de ses richesses. L’impérialisme est un système mondial, puissant, capable de soumettre les peuples aux pires oppressions. Il ne pourra être renversé que s’il est démoli au cœur, au sein même des grandes puissances impérialistes.
Cela ne signifie pas que les opprimés de ces îles doivent attendre les révoltes en métropole. Bien au contraire, là-bas, chaque révolte, chaque mouvement de contestation ouvre des possibilités et peut permettre de changer la donne. Toute la question est de savoir quelle politique, c’est-à-dire quelle organisation, quel parti, les révoltés trouvent sur leur chemin. Et cette question se pose tout autant en outre-mer qu’en métropole.
Dans le passé, les travailleurs et les pauvres des colonies n’ont trouvé sur leur chemin, à l’exception de Louise Michel qui a incarné par son histoire et sa présence en Nouvelle-Calédonie la possibilité d’unir les opprimés, que les organisations staliniennes qui ont, de fait, défendu l’impérialisme, ou des organisations nationalistes qui ont utilisé les opprimés comme masse de manœuvre, en leur faisant ravaler leurs revendications sociales. Il existe une autre voie, un autre programme pour les travailleurs autour duquel ils pourraient s’organiser. Celui du communisme révolutionnaire, dans la lignée de Marx et d’Engels, de la révolution d’Octobre, de la fondation du premier État ouvrier de l’histoire et des premiers congrès de l’Internationale communiste. Des travailleurs luttant pour le pouvoir dans ces îles derrière cette bannière seraient un formidable exemple de ce que des travailleurs révolutionnaires, même d’un petit territoire, sont capables de faire.
Pour qu’un tel courant révolutionnaire concurrençant les nationalistes puisse émerger, il faut déjà le faire entendre ici, en métropole. Il faut qu’existe un parti communiste révolutionnaire qui affirme que la lutte des opprimés de ces îles lointaines fait partie intégrante de la lutte des exploités des métropoles qui les ont asservis, pour renverser le capitalisme à l’échelle du monde. Un parti qui puisse propager au sein du prolétariat de métropole un sentiment de solidarité de classe totale avec ces opprimés contre son propre impérialisme.
Les peuples du Pacifique et de l’océan Indien doivent bien sûr pouvoir décider de leur avenir. Mais là-bas comme en France et comme partout dans le monde, il y a des classes sociales. Et la question est de savoir quelle classe sociale a le pouvoir et à qui profitent les richesses. Si durant toutes les luttes que ces peuples ont menées, la question, légitime, de l’indépendance nationale a été régulièrement posée, celle, encore plus cruciale, de l’indépendance politique des travailleurs et des pauvres vis-à-vis de leur bourgeoisie ou de leur petite bourgeoisie ne l’a jamais été.
Défendre la nécessité pour les travailleurs de s’organiser indépendamment pour défendre leurs intérêts politiques est notre raison d’être. Il est pour cela vital de ne pas s’aligner derrière les courants nationalistes, comme le font si souvent les organisations d’extrême gauche.
La priorité des militants communistes révolutionnaires que nous sommes est au contraire de défendre cette idée que les alliés des exploités sont leurs frères de classe, quelle que soit leur nationalité, et leurs adversaires, ceux qui exploitent leur travail. Ceux qui disent que « les Mahorais » sont tous unis ou que « les Kanaks » sont tous frères trompent les opprimés. Un riche et un pauvre, un capitaliste et un travailleur quand bien même ils seraient de la même origine ou de la même couleur de peau n’auront jamais les mêmes intérêts. À l’heure actuelle, un petit bourgeois kanak comme Dominique Katrawa, qui préside le conseil d’administration de la Société le Nickel, ne subit ni la même oppression coloniale ni surtout la même oppression sociale qu’un jeune chômeur de l’île, tout aussi kanak que lui, peut endurer, a fortiori s’il a le courage de protester contre cette oppression.
En revanche les travailleurs et les pauvres des îles se renforceront s’ils lient leur sort à celui de tous les opprimés qui vivent à leurs côtés. Une telle alliance constituerait le meilleur antidote contre le poison de la division que l’État, main dans la main avec la petite bourgeoisie locale, distille en permanence.
Parvenir à unifier tous ces opprimés serait un premier pas. Non seulement ils y puiseraient une force supplémentaire pour se battre contre la colonisation française. Mais surtout, en se reconnaissant les mêmes intérêts, les travailleurs et les pauvres du Pacifique et de l’océan Indien ouvriraient alors une perspective révolutionnaire.